

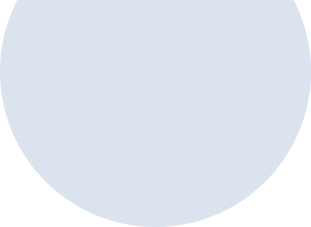



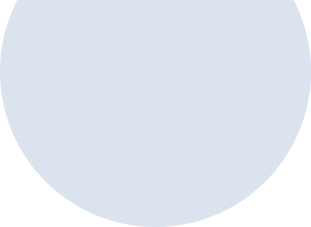

Dans sa définition première l’écothérapie se présente comme l’application pratique de l’écopsychologie.
L’écopsychologie reconnait les liens qui se tissent dès l’origine entre le corps vivant, le milieu naturel et l’existence humaine elle-même. Elle étudie la psychopathologie qui résulte de la dégradation de ces liens et ses répercussions sur le monde naturel.
L’écothérapie propose de prendre soin de la personne en réparant ces liens complexes et s’intéresse à leurs qualités. Ce faisant elle a aussi l’ambition d’éveiller, soutenir et développer la conscience écologique.
A partir de ces deux niveaux d’approche se sont développées des écothérapies :
En 2023, la fédération française Jardins Nature et Santé a opté pour cette définition de l’hortithérapie :
Acte thérapeutique holistique, s’inscrivant dans la durée, qui utilise le jardin, le jardinage et les relations avec la nature, en vue de prévenir, maintenir ou améliorer la santé physique, mentale et sociale, accompagné d’un ou de plusieurs professionnels qualifiés.
Si on se réfère à la définition de l’American Horticultural Therapy Association (AHTA), « l’hortithérapie consiste à utiliser les plantes et le végétal comme médiation thérapeutique sous la direction d’un professionnel formé à cette pratique pour atteindre des objectifs précis adaptés aux besoins du participant ».
Aux Etats-Unis, le « père de la psychiatrie américaine », Benjamin Rush, avait remarqué dès le 19e siècle les effets positifs du travail au jardin pour les « aliénés » et la Menniger Clinic a employé un hortithérapeute dès 1919. C’est en 1955 que le premier master en hortithérapie est créé à Michigan State University. La pratique de l’hortithérapie n’est pas une nouveauté de l’autre côté de l’Atlantique.
En France, on est plus frileux pour utiliser ce terme, faute pour l’instant de formations certifiantes et de reconnaissance de cette approche. Dans son livre « Jardins thérapeutiques et hortithérapie » (Dunod, 2022), Jérôme Pellissier propose de parler d’hortithérapies au pluriel pour reconnaître la variété des approches nourries de pratiques venues de champs différents.
Désireux de donner une définition simple de l’hortithérapie, il propose celle-ci :
« L’utilisation, s’inscrivant dans la durée, du jardin, du jardinage et des relations avec la nature, en vue d’améliorer son état (pourrait-on dire son être-à-soi, son être-aux-autres, son être-au-monde ?) et sa santé (incluant donc les dimensions bien-être, équilibre, capacité à prendre-soin de soi,…) avec l’aide d’un ou de plusieurs professionnels qualifiés (ayant donc les connaissances et la capacité pour). »
A noter que dans certains pays anglo-saxons (Royaume-Uni, Australie,…), on préfère le terme « therapeutic horticulture » à celui de « horticultural therapy », voire même le terme de « Social & Therapeutic Horticulture » (STH) avec des définitions cependant très similaires. C’est ainsi que depuis 2023, le « World Therapeutic Horticulture Day » a été lancé pour célébrer la pratique dans toute sa diversité dans le monde entier.


Tous les jardiniers savent que le jardin a des vertus thérapeutiques. Ils ressentent la capacité de leur jardin à leur faire du bien et à leur apporter du plaisir. Cependant, un jardin thérapeutique va plus loin.
Comme le décrit l’American Horticultural Therapy Association (AHTA), « un jardin thérapeutique est un environnement dominé par les plantes, conçu pour faciliter l’interaction avec les éléments thérapeutiques de la nature. »
Dans leur livre « Healing Gardens : Therapeutic Benefits and Design Recommendations » (Wiley, 2014), Clare Cooper Marcus et Naomi Sachs distinguent :
Cependant, les jardins thérapeutiques se reconnaissent à certains traits communs :
On parle de jardins thérapeutiques, mais aussi de jardins à visée ou à but thérapeutique ou encore de jardins de soins.
Pour tous.
La nature prend soin de nous et soigne nos vulnérabilités :
Nous sommes des êtres de Nature, sa fréquentation est bénéfique pour notre santé.
Plus notre environnement est vert et plus nous nous y connectons, plus nous augmentons nos chances d’être en bonne santé physique, psychique, sociale et cognitive.
Plus nous favorisons notre qualité de vie.

